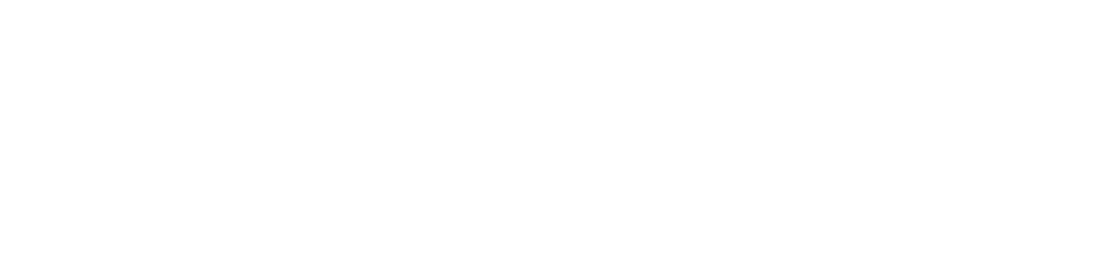Il y a en français une lettre de différence entre les deux verbes préparer et réparer : le premier caractérise la mission de Jean-Baptiste, Préparer comme Précurseur, – « Préparez le chemin du Seigneur », et le deuxième la mission du Christ, Réparer comme Rédempteur.
Réparer, restaurer, rendre droits les cœurs blessés, le Pape François y a consacré la 2ème partie de son Encyclique sur le Cœur sacré de Jésus, Dilexit nos (Il nous a aimés), le mot ‘réparation’ y étant utilisé près de 30 fois.
Ce terme de réparation peut sembler bizarre, presque incongru dans le champ religieux : on répare une machine, à la rigueur une partie du corps humain. Le terme est cependant courant dans le domaine juridique, et canonique du Droit de l’Eglise, pour la réparation d’une faute ou d’un crime.
La réparation fait partie intégrante du sacrement de la confession : il ne suffit pas que la faute soit regrettée, confessée, pardonnée, il faut que son dommage soit réparé, le mal commis et la peine suscitée compensée par un bien plus grand, que nous appelons la pénitence. Par le mal que j’ai fait, j’ai tiré l’humanité vers le bas ; sauvé par le Christ, je participe par des œuvres de réparation à son relèvement vers le haut, sa restauration en vue de la résurrection. C’est ce que dit l’expression : ‘toi tu cherches à te faire pardonner’, qui signifie en fait : ‘toi, tu sais que je t’ai pardonné parce que je t’aime et tu cherches maintenant à réparer’.
Je vous ai proposé pour cet Avent de nous tourner vers l’Esprit-Saint. Une de ses invocations les plus anciennes, le Veni sancte Spiritus le reconnaît comme plénitude de Dieu et lui demande de venir « remplir jusqu’à l’intime le cœur de tes fidèles » (pour que le Christ vive en nous) et les trois phrases qui suivent sont une synthèse de son action :
« Sans ta puissance divine, il n’est rien,
en aucun être humain, qui ne soit sans tache ».
C’est la doctrine du péché originel, dont nous fêterons demain l’exception, la Vierge Marie, la seule à en avoir été préservée, par son Immaculée Conception, signe que cette blessure n’est pas constitutive de notre humanité, ni une fatalité à laquelle se résigner.
« Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé » :
Magnifique image du baptême, dont Jean-Baptiste n’était que le Précurseur de Celui qui est venu nous baptiser dans l’Esprit-Saint.
« Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé ».
Nous pourrions presque dire : répare ce qui est tordu. Qui peut dire en effet qu’il n’a rien de faux en lui, de faux ou de faussé, de tordu ou de blessé ?
J’avais cité dans une homélie le 15 septembre dernier (en vous promettant d’y revenir) cette expression surprenante du Catéchisme qui parle par trois fois du « drame de la prière » (CEC 2570. 2598. 2606).
Le drame de la prière ?!
Et nous qui pensions au contraire qu’elle est le lieu de la paix et du réconfort ?
Qu’est-ce que le ‘drame de la prière’ ?
Un drame n’est pas une tragédie, dramatique dans son issue, ni une comédie, qui joue sur les sentiments. Par ‘drame de la prière’, il faut entendre le décalage entre la plénitude d’amour de Dieu et la mesure que nous prenons de nos fragilités.
Dans une catéchèse sur l’Esprit Saint du 27 novembre dernier, le Pape François rappelait que les fruits de l’Esprit-Saint (« amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi » Gal 5, 23) sont « le résultat d’une collaboration entre la grâce et notre liberté ». C’est la définition de la prière : la rencontre de la grâce de Dieu et de notre liberté.
D’où le drame, car c’est bien un drame puisqu’il en va de notre vie, lorsque cette rencontre ne se fait pas.
‘Je prie de temps en temps’ est la réponse qui m’est souvent faite lorsque j’interroge mes visiteurs sur la prière. De temps en temps. Une femme qui était venue me demander de prier pour elle avait employé la même expression à propos de ses enfants : ‘ils m’appellent ‘de temps en temps’. C’est moins de solitude qu’elle souffrait que d’abandon, dans les difficultés de sa vie.
Dans ses considérations sur le cœur qui constituent la 1ère partie de son encyclique, le Pape François dit que « le cœur est le lieu de la sincérité ». Il devrait l’être. Dans la parabole du Pharisien et du Publicain, la 3ème parabole de l’évangile de saint Luc sur la prière (après celle du juge inique et la veuve importune au même chapitre 18, et celle au chapitre 11 de l’ami importun qui vous dérange en pleine nuit), le Pharisien qui se trouvait merveilleux était sincère, comme il était sincère dans son mépris pour le Publicain. Sincère et autocentré.
La sincérité, purement subjective, dessèche le cœur. Le drame de la prière vient de la tentation de se concentrer sur soi, de se contenter de soi, au lieu de nous ouvrir au Cœur du Christ transpercé sur la Croix, tentation de se parler à soi-même dans la prière comme si Dieu n’était pas là.
Nous ne parlons plus beaucoup d’expiation qui vient d’un mot latin qui signifie purifier. Nettoyer, expier, purifier avant de réparer : c’est le baptême de conversion que proclamait Jean-Baptiste, le Précurseur, pour se préparer à accueillir le Rédempteur, celui qui répare nos cœurs blessés.
Et si nous commencions nos prières en invoquant l’Esprit-Saint ?
Demandons-lui de purifier ce qui est souillé pour que le Christ puisse réparer ce qui est blessé.
Le drame de la prière vient de notre indulgence pour nos péchés.
Père Christian Lancrey-Javal, curé
Vous avez la possibilité de recevoir les homélies du Père Lancrey-Javal en remplissant ce formulaire